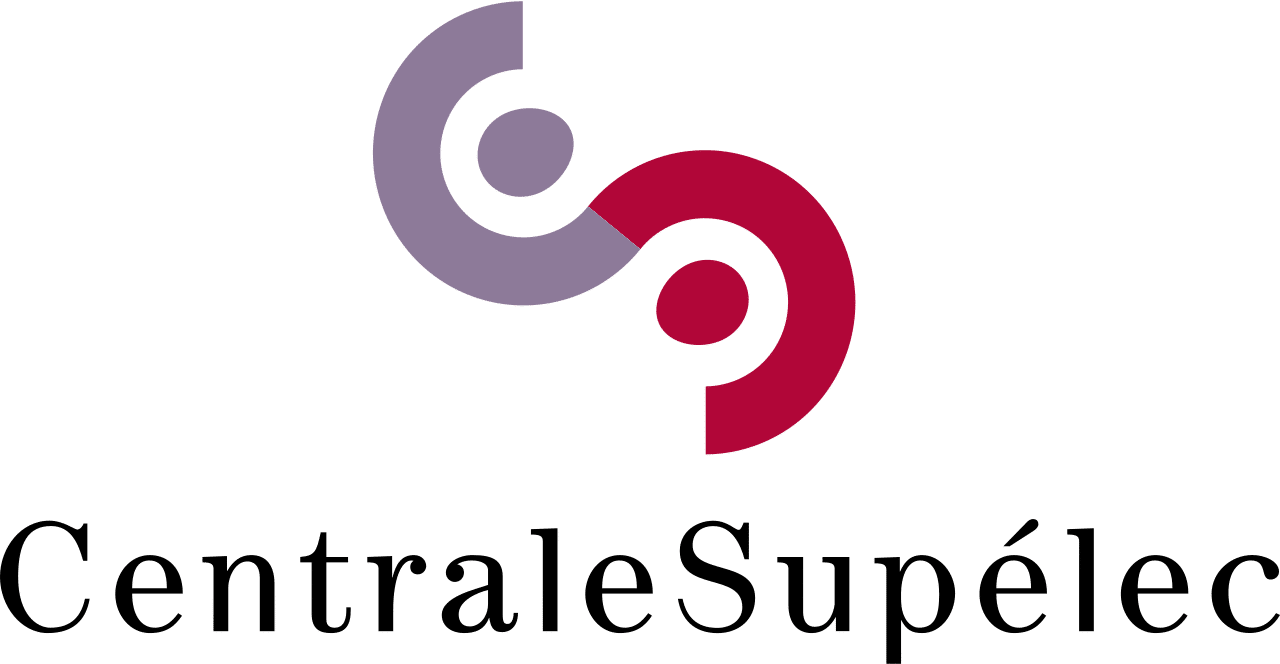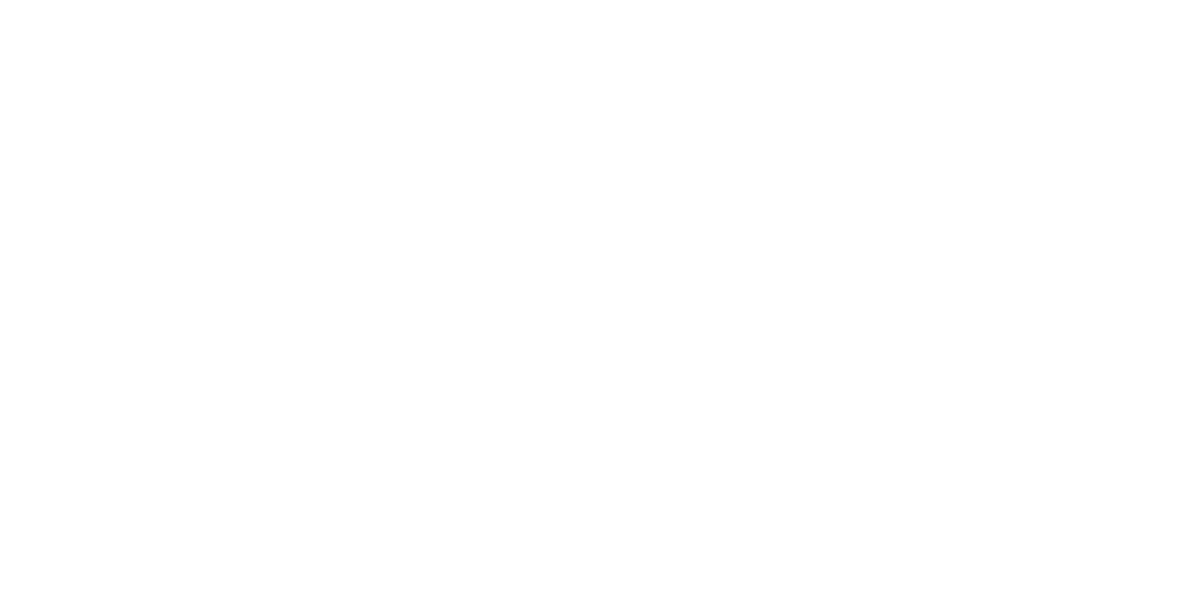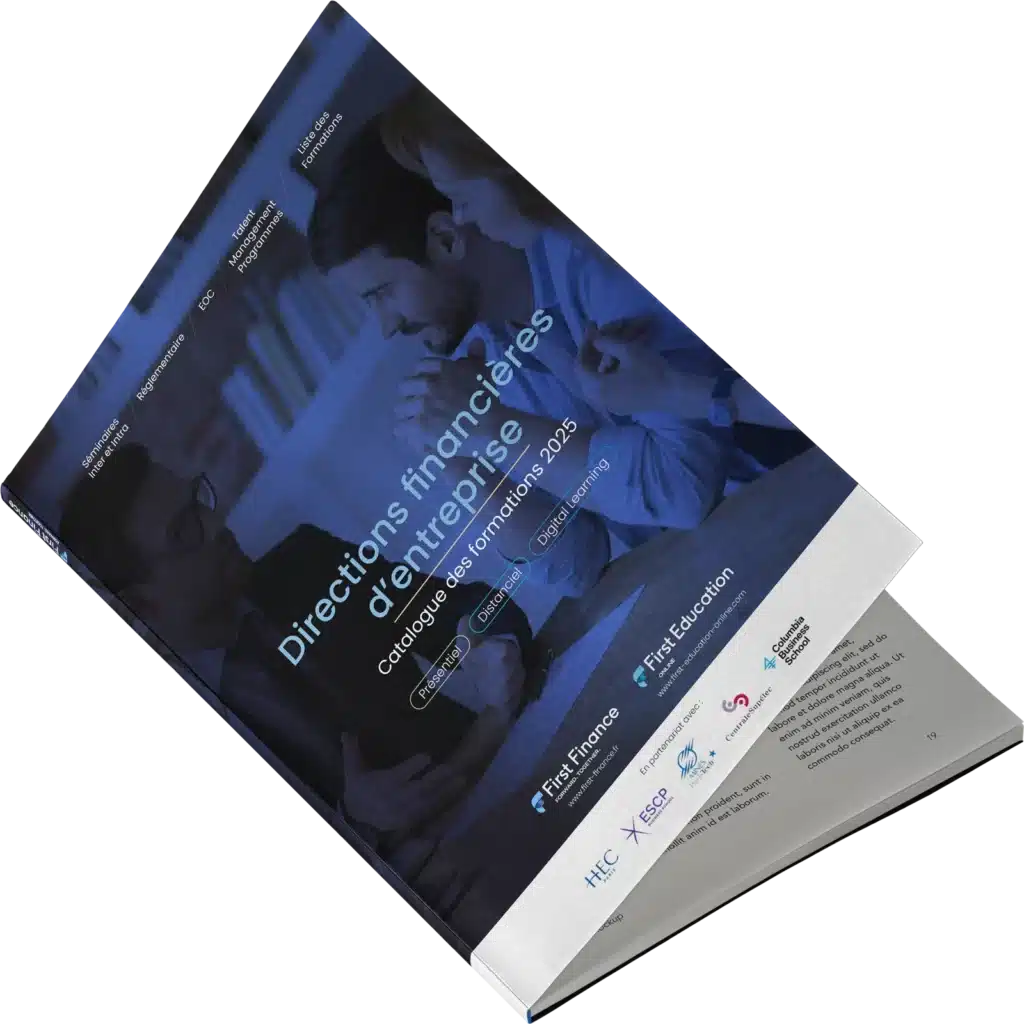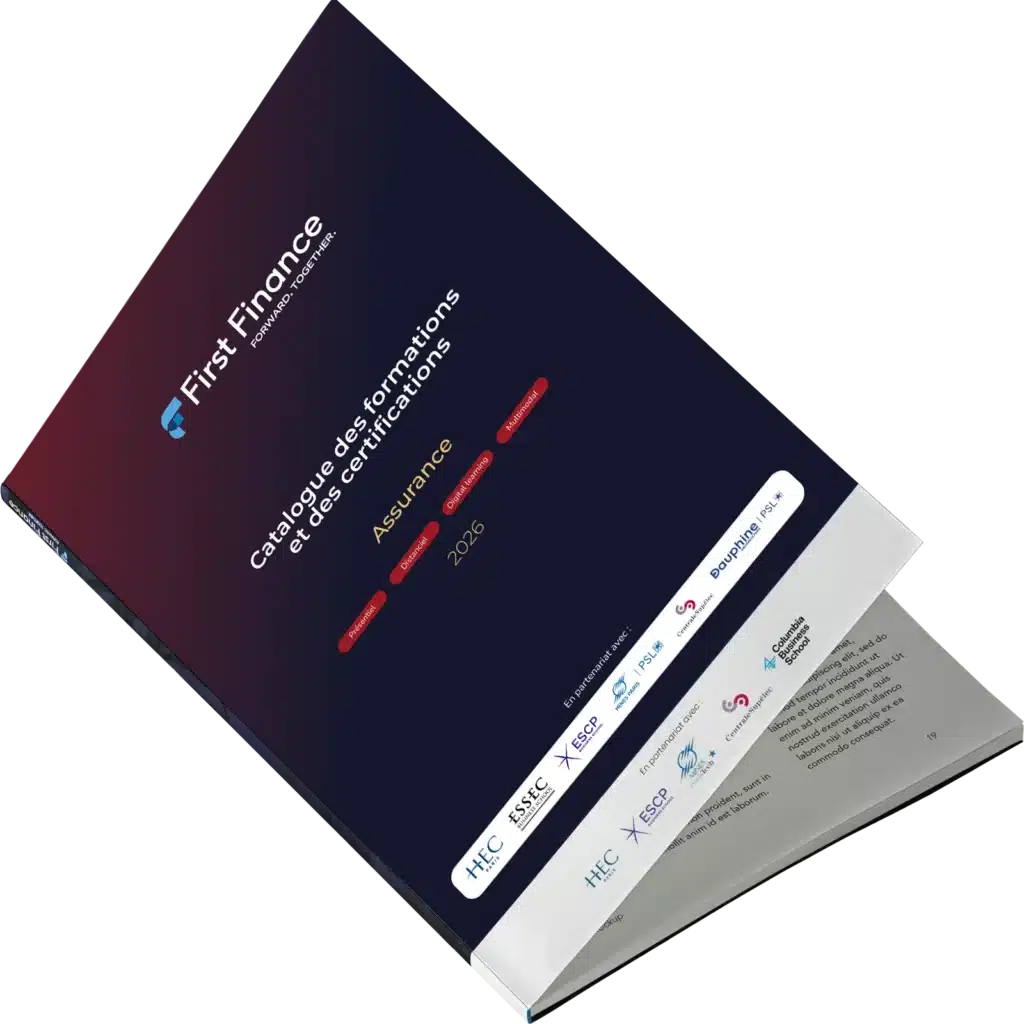Les entreprises doivent désormais composer avec une double exigence : répondre aux impératifs économiques tout en limitant leur impact environnemental, social et éthique. La prise en compte des émissions de gaz à effet de serre, la réduction de l’empreinte carbone, la lutte contre la corruption ou encore le respect des droits humains ne sont plus des options, mais des exigences portées par la réglementation, les investisseurs et la société civile.
Cet article explore les fondements des critères ESG – Environnement, Social, Gouvernance – leur application concrète dans les entreprises, les normes de référence comme IFRS S1/S2, GRI, ESRS ou ISO 14064, et les cadres réglementaires européens tels que la directive CSRD et le règlement SFDR.
Nous verrons aussi comment les performances ESG sont de plus en plus corrélées aux performances financières et pourquoi elles représentent un enjeu stratégique pour les conseils d’administration, les responsables financiers et les professionnels de la gestion des risques.Inscrivez-vous à nos formations ESG : Sustainable Investing Certificate et Concevoir un produit financier « ESG » et une offre bancaire
En résumé
| Thématique clé | Critères ESG |
| Objectifs ESG | Réduire les risques, améliorer la résilience, accroître la transparence et renforcer la performance. |
| Enjeux environnementaux | Réduction des GES, empreinte carbone, gestion des ressources, adaptation climatique, biodiversité. |
| Enjeux sociaux | Santé, sécurité, inclusion, égalité professionnelle, dialogue social, impacts territoriaux. |
| Enjeux de gouvernance | Éthique, lutte anti-corruption, transparence, indépendance du CA, contrôle interne, responsabilité. |
| Cadres réglementaires | CSRD, ESRS, SFDR, normes IFRS S1/S2, GRI, ISO 14064, taxonomie européenne – obligations de reporting extra-financier standardisé. |
| Étapes de mise en œuvre | Diagnostic, objectifs chiffrés, KPI, pilotage, audit externe, outils digitaux, implication du CA. |
Comprendre les critères ESG
Les critères ESG, initialement promus par les Nations Unies, se sont imposés au sein des comités d’investissements, des conseils d’administration et dans les bilans extra-financiers.
Ils élargissent l’analyse de la performance d’une entreprise à des dimensions extra-financières, devenues centrales dans la gouvernance et les décisions d’investissement.
Trois grands axes structurent cette évaluation.
Environnement : mesurer et réduire l’empreinte écologique
Ce pilier porte sur la manière dont l’entreprise gère son impact écologique. Sont notamment pris en compte les niveaux d’émissions de gaz à effet de serre (émission de CO2), les politiques de réduction de l’empreinte carbone, la consommation d’énergie, la gestion des déchets, la préservation de la biodiversité et l’adaptation au changement climatique.
Intégrer ces dimensions permet à l’entreprise de mieux anticiper les risques environnementaux, de respecter les réglementations à venir, et de renforcer sa résilience face aux mutations climatiques.
Social : responsabilité sociétale et performance sociale
Le pilier social concerne le traitement des collaborateurs, l’égalité professionnelle, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social, l’inclusion, ainsi que les impacts sociaux sur les territoires et les parties prenantes externes.
Cette dimension reflète la responsabilité sociale des entreprises et leur capacité à créer un environnement de travail équitable, éthique et attractif.
Gouvernance : transparence, éthique, intégrité
Enfin, le volet gouvernance évalue l’organisation interne de l’entreprise : composition et indépendance des conseils d’administration, lutte contre la corruption, transparence dans la rémunération des dirigeants, éthique des affaires, contrôle interne et relations avec les actionnaires.
Une gouvernance saine est essentielle pour piloter une stratégie ESG efficace et crédible.
Pourquoi l’ESG est devenu un critère de référence ?
L’intégration des critères ESG n’est plus l’apanage de quelques pionniers. Elle est désormais portée par des textes réglementaires structurants, des attentes sociétales accrues et une évolution profonde des marchés financiers.
Ces critères sont devenus incontournables pour toute entreprise souhaitant conjuguer performance économique et impact positif sur la société.
ESG et performance financière : un tandem gagnant
Contrairement aux idées reçues, adopter une démarche ESG rigoureuse ne se fait pas au détriment de la rentabilité. Bien au contraire. Plusieurs études démontrent une corrélation positive entre les performances ESG et la performance financière des entreprises. Selon McKinsey, 70 % des études montrent une meilleure rentabilité, une valorisation plus élevée et un coût du capital inférieur d’environ 10 % pour les entreprises intégrant l’ESG.
En réduisant leurs risques (environnementaux, juridiques, réputationnels), les organisations qui maîtrisent leurs engagements ESG attirent davantage d’investisseurs, bénéficient d’un meilleur accès au financement et génèrent plus de valeur à long terme.
Un cadre réglementaire en pleine structuration : CSRD, ESRS, SFDR
CSRD et ESRS : un reporting extra‑financier plus exigeant
La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), entrée en vigueur dès 2025 pour les grandes entreprises et en 2026 pour les PME cotées, impose un reporting ESG détaillé basé sur les normes ESRS. Elle oblige les entreprises à publier des informations vérifiées, structurées et auditables sur leur impact environnemental, social et de gouvernance.
Ces rapports doivent couvrir la double matérialité : l’impact de l’entreprise sur l’environnement et la société, et l’impact de ces enjeux sur sa performance. Les données, validées par un audit externe (assurance limitée), doivent être soumises de manière numérique et vérifiable.
Un « stop-the-clock » (avril 2025) et un plan omnibus recentrent les obligations sur les entreprises de plus de 1000 salariés ou générant plus de 450 M€ de chiffres d’affaires dans l’UE.Formez-vous à la CSRD avec nos programmes : Initiation à la Finance durable : CSRD et taxonomie, Formation CSRD : Analyse extra-financière.
Des normes internationales alignées : IFRS S1/S2, GRI, ISO 14064
Pour garantir l’harmonisation des données et leur comparabilité, plusieurs cadres normatifs ont émergé.
Les normes IFRS S1 et S2, publiées par l’ISSB, imposent un reporting standardisé sur la durabilité et le climat.
Les standards GRI (Global Reporting Initiative) et la norme ISO 14064 (quantification des émissions de GES) viennent compléter ce paysage réglementaire.
En Europe, les 12 normes ESRS (E1 à E5, S1 à S4, G1) structurent le reporting imposé par la CSRD.
SFDR et taxonomie : encadrer la finance durable
Le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) classe les produits financiers selon leur niveau d’engagement ESG. À partir de 2025, les fonds dits « verts » devront investir au moins 80 % dans des actifs durables pour conserver cette appellation. La taxonomie européenne, quant à elle, définit les activités réellement durables, afin d’éviter le greenwashing.
Pour aller plus loin : Finance verte et climatique : enjeux, stratégies d’investissement et outils
Une dynamique appelée à s’intensifier
L’extension progressive des obligations de reporting, notamment avec la directive CSRD pour les PME à partir de 2026, renforce l’universalité des critères ESG. Toutes les entreprises, quel que soit leur secteur ou leur taille, seront concernées. La notion de double matérialité, imposant d’évaluer à la fois l’impact de l’entreprise sur son environnement et l’influence de ces enjeux sur sa performance, devient la nouvelle norme.
Découvrez notre article sur le Label Greenfin
Comment mettre en œuvre une stratégie ESG efficace ?
Des étapes clés à structurer
Étape 1 : diagnostic et cartographie des risques
La démarche ESG des entreprises commence par la mesure des émissions de CO₂, idéalement selon la norme ISO 14064. Vient ensuite l’identification des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Une cartographie rigoureuse permet de hiérarchiser les actions prioritaires.
Étape 2 : définition d’objectifs clairs
Les objectifs doivent être quantifiés et temporellement définis : réduction des émissions de GES de X % d’ici à 2030, augmentation de la diversité à Y %, renforcement de la gouvernance interne, etc. Le tout, aligné avec les standards ESG.
Étape 3 : indicateurs de performance et pilotage
Les KPI (empreinte carbone, diversité, taux d’accidents, votes en AG…) doivent être mesurés régulièrement, intégrés aux systèmes d’information et pilotés. Le tableau de bord ESG devient un outil stratégique.
Étape 4 : gouvernance et implication du management
Le conseil d’administration doit être impliqué activement dans la définition et le suivi de la stratégie ESG. Ce pilotage assure crédibilité, transparence et cohérence avec les enjeux à long terme.
Étape 5 : audit et assurance externe
Conformément à la CSRD, les données ESG doivent recevoir une assurance limitée. L’audit externe garantit leur fiabilité et crédibilise le reporting.
Étape 6 : outils technologiques et plateforme ESG
L’utilisation de plateformes spécialisées (reporting, data management) favorise la traçabilité, la conformité et l’automatisation des reportings SFDR, CSRD… Ces outils sont désormais incontournables pour structurer efficacement la démarche.
Un pilotage à intégrer au cœur des instances dirigeantes
Les conseils d’administration ont un rôle déterminant dans le succès d’une stratégie ESG.
Leur implication dans la définition des priorités, la supervision des indicateurs extra-financiers et la validation des reportings est aujourd’hui une attente forte des investisseurs et des régulateurs.
Cette gouvernance responsable est un facteur clé de différenciation pour les entreprises.
Le rôle croissant des directions financières et des métiers de la conformité
La montée en puissance des critères ESG transforme également les fonctions financières. Les directions financières doivent intégrer des données extra-financières dans leurs analyses, modéliser l’impact des risques climatiques sur les résultats futurs, et ajuster leur stratégie d’investissement ou de financement.
Les métiers de la conformité et du contrôle interne, eux, s’assurent de la fiabilité des données ESG, de la cohérence des politiques internes et du respect des obligations réglementaires.
Former pour agir : un enjeu clé pour les professionnels de la finance
Dans ce contexte, les professionnels de la finance – contrôleurs de gestion, analystes, investisseurs, risk managers – doivent acquérir une maîtrise complète des outils, normes et indicateurs liés aux critères ESG.
La finance durable n’est plus un domaine marginal : elle structure de plus en plus les décisions économiques et nécessite un socle de compétences techniques, stratégiques et réglementaires.
Les formations proposées par First Finance accompagnent cette montée en compétence en couvrant l’ensemble des référentiels et en proposant une approche opérationnelle adaptée aux enjeux du secteur.
Conclusion – L’ESG comme moteur d’une finance durable
Les critères ESG permettent non seulement de réduire les risques et d’améliorer les performances extra-financières, mais aussi d’accroître la compétitivité à long terme.
Ils incarnent une mutation profonde de l’économie vers un modèle plus durable, responsable et transparent.
Pour les professionnels de la finance, ils représentent un nouveau standard d’analyse, un levier stratégique de transformation, et un socle indispensable pour bâtir une finance alignée avec les attentes de la société.
FAQ
Quels sont les 3 critères ESG ?
Les trois critères ESG sont les suivants :
- Environnemental : émissions de gaz à effet de serre, empreinte carbone…
- Social : droits des employés, conditions de travail…
- Gouvernance : conseil d’administration, lutte anti‑corruption
Quels sont les trois piliers des critères ESG ?
Les trois piliers ESG sont identiques aux critères : Environnement, Social, Gouvernance.
C’est quoi la norme ESG ?
La norme ESG, c’est l’ensemble des standards (GRI, SASB, IFRS S1/S2, ESRS, ISO 14064…) permettant de structurer le reporting ESG
Quelles sont les 4 grandes normes ESG ?
Il existe plusieurs référentiels internationaux permettant de structurer le reporting ESG. Voici les 4 grandes normes les plus utilisées à l’échelle mondiale et européenne :
- GRI (Global Reporting Initiative) : l’un des cadres les plus anciens et les plus largement adoptés pour le reporting de durabilité. Il propose des indicateurs standards pour rendre compte de l’impact environnemental, social et économique des organisations.
- SASB (Sustainability Accounting Standards Board) : cette norme se concentre sur les informations ESG les plus pertinentes selon le secteur d’activité, avec un accent mis sur la matérialité financière. Elle est souvent utilisée par les investisseurs pour comparer les entreprises.
- IFRS S1/S2 (normes de l’ISSB) : élaborées par l’International Sustainability Standards Board, ces deux normes visent à harmoniser le reporting de durabilité et de climat à l’échelle mondiale, en complément des normes comptables financières IFRS. Elles deviendront progressivement la référence pour les entreprises cotées.
- ESRS (European Sustainability Reporting Standards) : imposées par la directive européenne CSRD, ces normes encadrent le reporting ESG obligatoire en Europe. Elles couvrent 12 domaines (environnement, social, gouvernance) et introduisent la notion de double matérialité.
Ces normes ne sont pas exclusives les unes des autres. De nombreuses entreprises combinent plusieurs référentiels pour répondre aux attentes des régulateurs, des investisseurs et de leurs parties prenantes.
Quelle est la différence entre ESG et RSE ?
- La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) désigne une démarche volontaire par laquelle une entreprise intègre des préoccupations sociales, environnementales et éthiques dans ses activités. Elle reflète un engagement global, souvent qualitatif, orienté vers ses parties prenantes internes et externes.
- L’ESG (Environnement, Social, Gouvernance), quant à lui, est un cadre normé et quantifiable utilisé principalement par les investisseurs et les analystes pour évaluer la performance extra-financière des entreprises. Il s’appuie sur des indicateurs mesurables et des standards (comme CSRD, SFDR, ESRS) pour orienter les décisions d’investissement et le reporting réglementaire.
En résumé, la RSE est une démarche interne et volontaire, tandis que l’ESG constitue un référentiel externe, structuré et de plus en plus obligatoire dans un contexte de finance durable. Les deux sont complémentaires : la stratégie RSE peut nourrir le reporting ESG, et l’ESG permet de valoriser les engagements RSE auprès du marché.
Que signifie ESG ?
ESG est un acronyme anglais : Environmental, Social, Governance.
Quels sont les 3 niveaux de reporting ESG ?
Le reporting ESG peut être structuré en trois grands niveaux, selon le degré d’engagement, de précision et de conformité réglementaire :
- Reporting volontaire : il s’agit de démarches initiées par l’entreprise, souvent issues de sa politique RSE. Ce reporting repose sur des indicateurs choisis librement, parfois inspirés de référentiels comme le GRI ou la norme ISO 14064. Il n’est pas soumis à des obligations réglementaires, mais répond à une volonté de transparence auprès des parties prenantes.
- Reporting semi-réglementé : certaines entreprises doivent se conformer à des exigences de transparence dans le cadre d’initiatives sectorielles ou de labels (comme le label ISR en France). Dans le secteur financier, le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) impose un niveau de transparence ESG pour les produits financiers dits durables (articles 6, 8, 9).
- Reporting réglementaire obligatoire : avec la directive européenne CSRD, les grandes entreprises (et bientôt certaines PME) doivent produire un reporting extra-financier standardisé, basé sur les normes ESRS. Ce reporting est soumis à audit, à publication numérique et à la logique de double matérialité (impact de l’entreprise sur l’environnement et vice-versa).
Ces trois niveaux traduisent une montée en puissance progressive des exigences ESG, passant d’un engagement volontaire à une obligation légale, encadrée par des normes strictes et des contrôles externes.